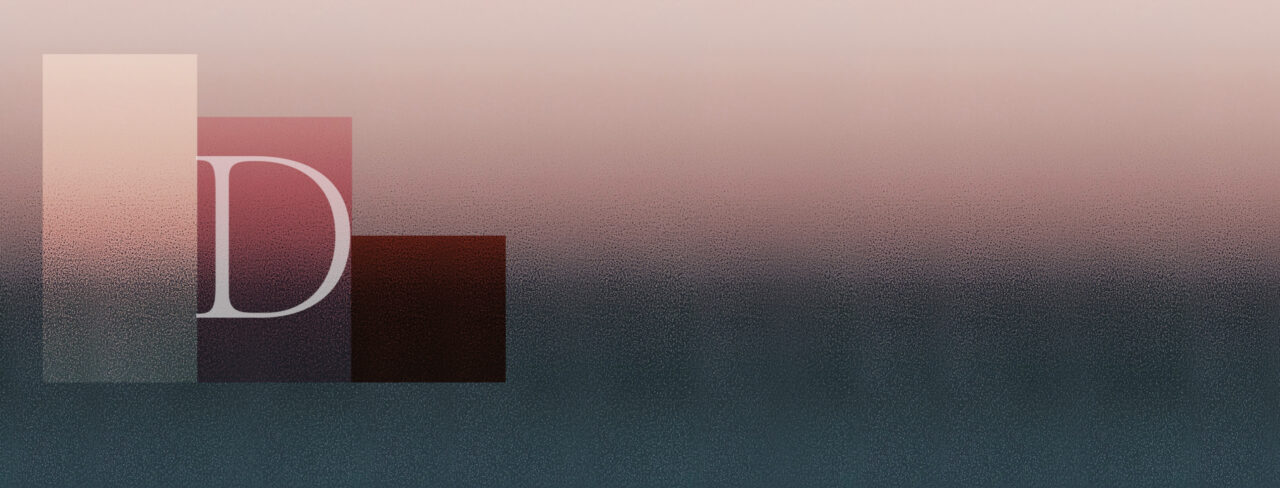
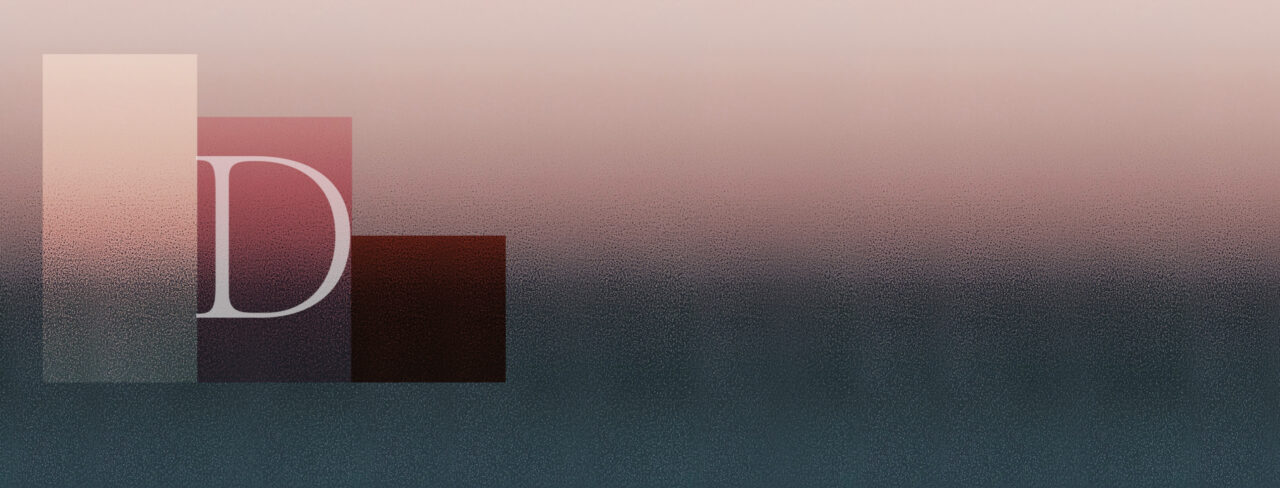
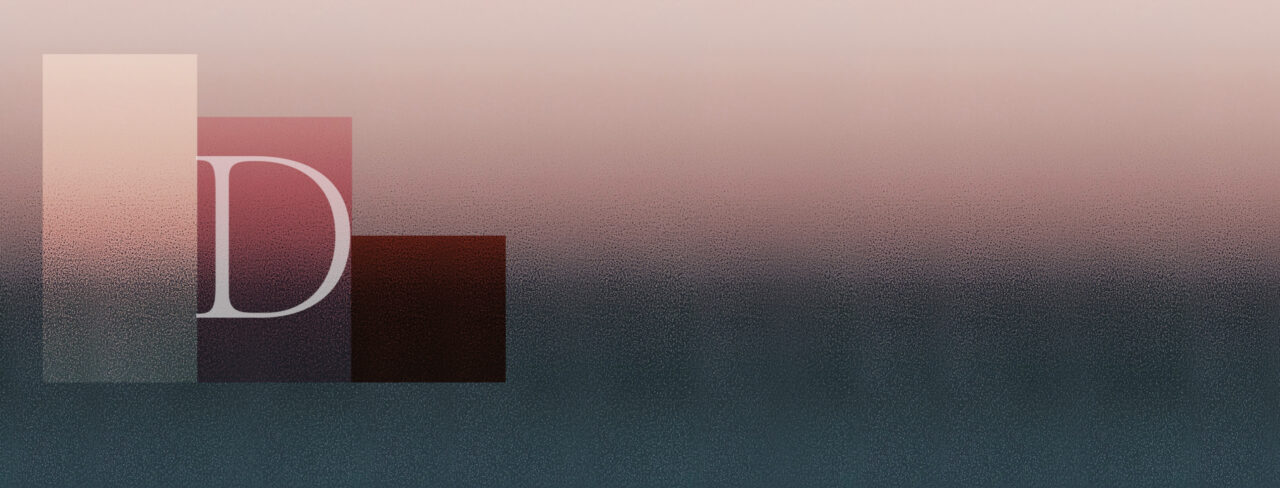
Série Science USA : Evidences ouvre une nouvelle série de notes d’actualité sur les attaques conduites par l’administration Trump contre la science.

Le 8 décembre 2025, le CNRS a présenté les résultats d’une initiative originale et innovante : pour la première fois, le CNRS a donné la parole aux citoyennes et citoyens sur leur rapport à une science, les mathématiques. Lancée le 10 mars 2025, la consultation nationale « Aux maths citoyennes, citoyens ! » a interrogé la place des mathématiques dans la société. L’idée était de s’appuyer sur les représentations des citoyens pour identifier les leviers permettant de favoriser l’accès de tous aux maths. Cette initiative s’inscrivait dans le prolongement des Assises des mathématiques (2022) et contribue à la réflexion nationale sur l’accès aux mathématiques à tous les âges de la vie.
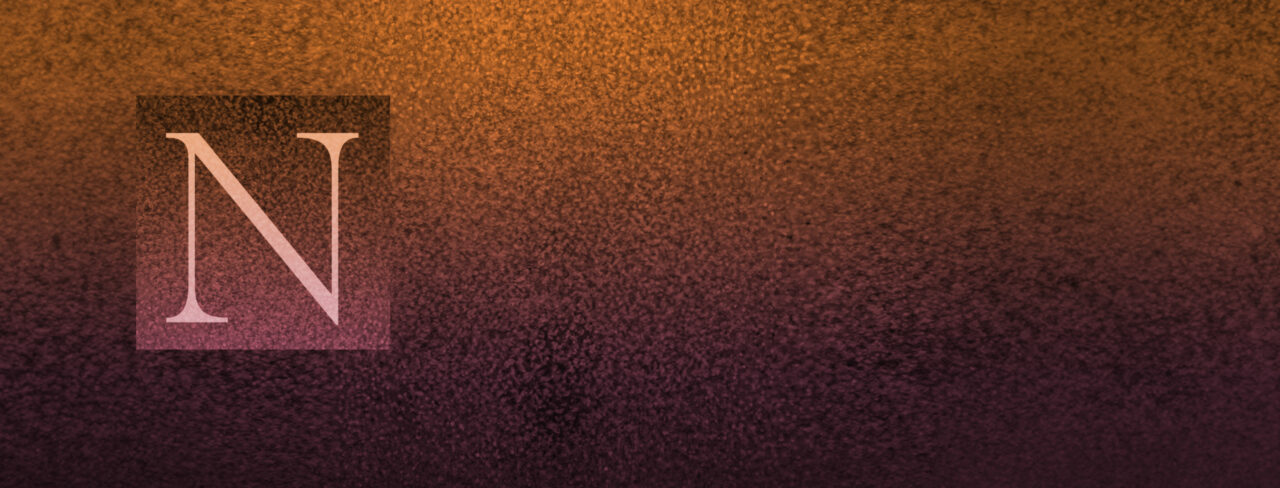
La science est-elle rentable, est-ce là le critère qui permet d’en justifier le financement public ? Dénoncée pour la lenteur de ses cheminements, la recherche fondamentale est menacée dans les budgets, la situation américaine en témoigne. Pourtant, les prix Nobel scientifiques annoncés ce mois-ci sont exemplaires de l’importance d’une science libre quel que soit son taux de succès en termes d’applications. La libre curiosité scientifique comme valeur : c’est justement l’enjeu politique que le prix Nobel d’économie décerné à Philippe Aghion met à l’honneur.
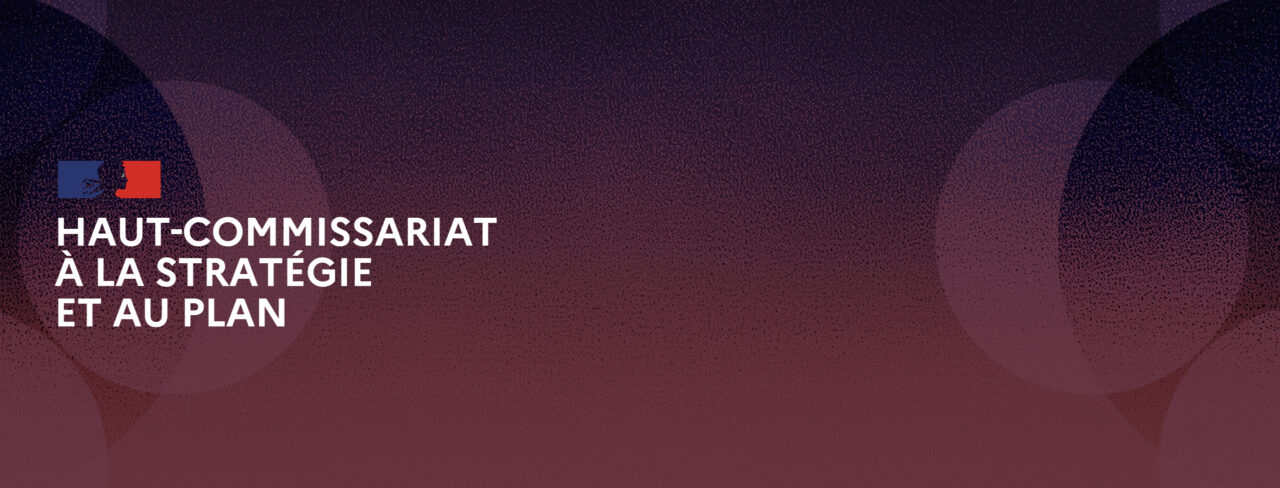
De quoi le récent épisode de la désormais fameuse loi Duplomb est-il le nom ?Cet épisode doit nous interroger sur les insuffisances institutionnelles qui ont rendu possible l’arrivée jusqu’au vote et à la promulgation d’une proposition de loi qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation ex ante de ses impacts sur la santé et l’environnement. Il serait irresponsable de ne pas en tirer des enseignements concrets non pour contraindre mais pour faciliter les débats etéviter qu’ils se tiennent, de manière plus polarisée, en dehors du Parlement.C’est l’objet de la présente note : dresser un état des lieux de l’articulation entre expertise scientifique et décision publique en France, pour proposer des réformes de nature à mieux garantir la place de la science dans l’écriture de la loi.Dans un monde livré à l’urgence et au règne de la post-vérité, il en va de la survie même de nos démocraties.

Le débat public autour de la science a pris une acuité particulière depuis la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le déni de la preuve scientifique n’est plus marginal : il entraîne des conséquences politiques majeures, fragilisant les politiques de santé, la transition écologique et, plus largement, les fondements démocratiques. Le rapport Draghi rappelle que l’innovation n’est pas un luxe économique, mais le socle de la cohésion sociale et de la politique européenne. La science est dès lors une priorité politique, condition de la croissance, du bien-être collectif et de la résilience démocratique.

La contestation de la loi Duplomb ravive la réflexion collective sur la place des savoirs scientifiques dans la décision publique. Chaque camp critique les failles de l’instruction scientifique conduite par l’autre – en particulier sur les incertitudes qui entourent l’impact de la réintroduction dérogatoire de l’acétamipride qui concentre la polémique. Quelle procédure d’instruction scientifique y a-t-il eu dans le vote de ce texte, quelles auditions d’experts, quelle bibliographie à l’appui des argumentaires politiques ? Ces questions se posent aujourd’hui dans le contexte particulier d’une proposition de loi, portée donc par un parlementaire sans étude d’impact préalable ; elles se posent aussi à l’aune de connaissances scientifiques dont chacun reconnaît le caractère encore trop incertain pour décider ; elles se posent enfin dans une perspective épistémique spécifique, celle d’un régime d’action dérogatoire. En démocratie, seule une instruction objective détaillée des biens que la décision engendre, mais aussi des maux qu’elle peut produire, permet de justifier qu’un travail de mise en balance politique, conscient et éclairé, préside aux décisions. C’est la condition pour que chacun puisse en juger les raisons. Au total, la séquence actuelle illustre que nous ne disposons pas d’un cadre normatif clair et partagé pour discerner ce que devrait être l’interface entre expertise et décision, quelle combinaison de neutralité axiologique et de finalité décisionnelle ou politique devraient l’organiser, ni quelles procédures permettraient d’y associer une opinion publique éclairée.

Alors que le vote de la loi Duplomb déclenche une vive controverse sur la place de l’expertise scientifique dans la décision publique et qu’une mobilisation citoyenne dénonce par pétition un décalage entre injonctions politiques et fondements scientifiques, les résultats de l’enquête internationale Timms de l’OCDE offrent une occasion opportune d’évaluer où en sont les connaissances et les attitudes des élèves français en matière d’environnement. Equipons-nous bien leur discernement pour les défis de demain et leurs dilemmes ? Verdict : avec à peine plus d’un élève sur 3 qui déclare accorder une très forte importance à la préservation de l’environnement en 4e, les élèves français se distinguent par rapport à leurs camarades d’autres pays de l’OCDE et de l’UE. Surtout, l’assise scientifique de leur engagement est en net décrochage.

La lutte contre la prolifération de la désinformation en ligne est à l’agenda politique, médiatique et scientifique. Acteurs publics, chercheurs en psychologie, sciences cognitives, économie, sociologie etc., entreprises de la tech, plateformes ou médias sont convoqués à une urgence démocratique et sociétale : concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions pour protéger la société du poison de l’obscurantisme.

Deux études récentes, parues dans Science (2024) et tout récemment dans Nature Human Behaviour (2025), mesurent la capacité des modèles de langage à faire évoluer l’opinion humaine dans un débat argumenté. Sur fond de fantasmes bien partagés de manipulation algorithmique, ces recherches interrogent ce que signifie convaincre, réviser son jugement, et …débattre avec les machines. On proposera ici une lecture critique croisée, épistémologique et méthodologique, de ces travaux.

Alors que Donald Trump est investi, l’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn et la politiste Mélanie Heard appellent, dans une tribune au « Monde », à une mobilisation politique pour défendre le rôle fondamental de la science dans la vie publique.